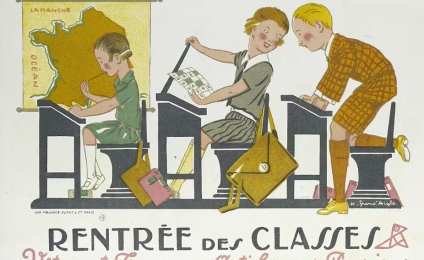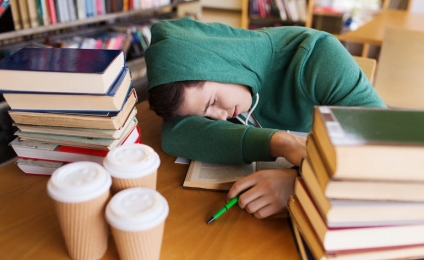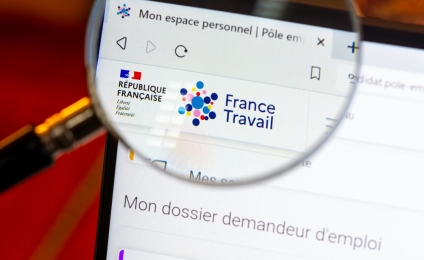Parmi les multiples sujets abordés au sein des productions culturelles destinées à la jeunesse, le sport occupe aujourd’hui une place non négligeable. Sa présence n’est toutefois pas nouvelle. Dès les années 1960, Babar fait par exemple du ski dans un album de Laurent de Brunhoff. Avant lui, Bécassine s’essaie également à différents sports. Et de nombreux autres personnages iconiques s’adonnent, au cours de leurs aventures, à des activités physiques.
Impossible d’évoquer ici toutes les productions concernées. À l’instar du douzième album d’Astérix conduisant le célèbre gaulois aux Jeux olympiques, adapté dans les années 2000 en jeu vidéo et au cinéma, la thématique sportive circule dans de très nombreux médias à destination des jeunes publics : littérature (BD, mangas, albums, documentaires, presse jeunesse, contes, etc.), jeux vidéo, dessins animés, etc.
Or, ces représentations du sport, composées par des adultes pour les enfants et les adolescents, ne sont jamais neutres. Elles visent régulièrement l’éducation des jeunes lecteurs et téléspectateurs à qui elles s’adressent. Ces mises en scène du sport sont intéressantes à étudier car elles révèlent ce qu’une société choisit de montrer des pratiques corporelles et, ce faisant, les modèles, normes, valeurs qu’elle souhaite transmettre aux jeunes générations.